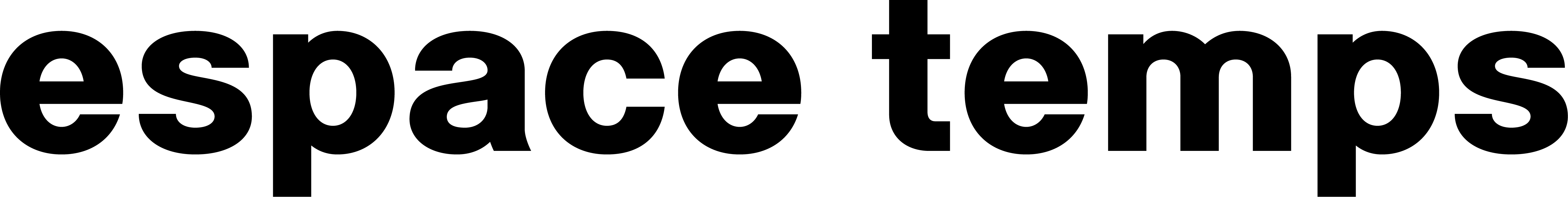(Un)Systemized
11 juin 2025 – 30 juin 2025
Vernissage le mercredi 11 juin à partir de 18h
Artistes: Liu Guangli & Wu Huimin | Thomas Garnier | So Kanno
Curatrice: Paula Zeng
L’horizon vacille. L’orientation est devenue désorientation.
— Hito Steyerl, In Free Fall: A Thought Experiment on Vertical Perspective*
espace temps présente : (Un)Systemized, exposition collective du 11 au 30 juin 2025, réunissant les œuvres récentes de quatre artistes : les deux artistes chinois Liu Guangli et Wu Huimin, basé à France, l’artiste français Thomas Garnier, et l’artiste japonais So Kanno, basé à Berlin.
Dans un monde régi par les algorithmes et l’automatisation, la systématisation agit comme un pouvoir invisible — fluide, tentaculaire, omniprésent. (Un)Systemized interroge cette tension entre contrôle et déraillement, entre organisation apparente et désordre latent. À l’intérieur de cet équilibre instable, faire sens devient un acte ambigu : entre raisonnement analytique et projections sensibles, l’interprétation elle-même devient outil de transformation du réel. Face à l’émergence de nouveaux systèmes dits « intelligents » qui interfacent notre perception de l’information, et par conséquent celle du monde, les structures forgées par l’humanité, qu’elles soient politiques, technologiques ou symboliques, vacillent, mutent ou s’effondrent. Dans ce temps comprimé où le passé, le présent et le futur se confondent, où le naturel et l’artificiel se superposent, nos repères s’étiolent. Qui sommes-nous dans ce monde où les seuils s’effacent ?
Les quatre artistes de cette exposition œuvrent à la croisée de plusieurs disciplines, intégrant l’intelligence artificielle, l’impression 3D, la programmation robotique. Leurs propositions explorent, avec des langages plastiques variés, les tensions contemporaines liées à la perception, au pouvoir et à la technologie. Chaque œuvre devient ainsi un capteur de l’invisible, une forme d’alerte ou de rituel dans un monde en mutation.
L’exposition s’ouvre sur Seeing Silence (2025), une installation vidéo de Liu Guangli et Wu Huimin, à partir d’un examen de l’évolution des infrastructures énergétiques, croisant les récits techniques à la poésie visuelle des explosions au ralenti. On y observe la lente autodestruction d’objets électroniques : disjoncteurs, circuits, câblages — témoins d’un monde saturé par ses propres dispositifs. L’image, étirée image par image, engendre une esthétique de la ruine : une archéologie inversée où les cendres dessinent l’amorce d’un futur incertain. Entre les composants pulvérisés, surgit l’idée d’un sol en gestation, d’un désordre fertile. Cette destruction devient acte de résistance, refus d’un système de contrôle opaque.
Dans un dialogue silencieux, les œuvres sculpturales de Thomas Garnier prolongent cette réflexion sur la ruine et la mutation. Ses architectures imaginaires, dérivées de formes classiques ou industrielles, se présentent comme des vestiges d’un monde parallèle. Dans Exuviae I-III, la colonne effondrée devient icône d’un temps aboli : sa surface est érodée artificiellement, révélant en son cœur une structure filaire, légère, presque numérique — squelette fragile d’un monde révolu ou à venir. Dans Liminiarium(alpha), un dispositif mécanique met en mouvement une suite d’arches imprimées en 3D, en perpétuelle reconfiguration. Le passage devient seuil mouvant, paysage d’un éternel recommencement.
Dans l’espace souterrain, l’installation Augures (Forest) de Thomas Garnier déploie une forêt suspendue, lente et spectrale. Sur des rails motorisés, des sources lumineuses traversent des bas-reliefs imprimés en résine, inspirés des lithophanies translucides du XIXe siècle. Les images générées par intelligence artificielle — paysages, architectures, données — apparaissent et disparaissent selon l’angle et l’intensité de la lumière. Comme dans la grotte de Lascaux, le regard est conditionné par le feu, ici remplacé par le déplacement mécanique d’une lumière froide. Les structures de vie artificielle — serveurs, câbles, centres de données — y deviennent des lianes d’un nouveau monde, post-humain et rituel. L’humain s’y tient à genoux, en prière, devant des dieux technologiques silencieux.
Dans ce théâtre d’ombres, les ruines ne sont plus mortes : elles respirent à travers les gestes de la machine, rejouent à l’infini la mémoire d’un monde qui hésite entre mythe et mémoire vive.
Résonnant dans les espaces, Chirping Machines de So Kanno, les systèmes de communication naturelle, tels que les chants d’oiseaux et les coassements de grenouilles, deviennent matières premières pour un langage recréé par la machine. Par la programmation algorithmique, l’artiste génère un nouvel écosystème sonore où les animaux semblent dialoguer, écouter et moduler leurs appels selon une logique qui est conçue par l’humain. Cette œuvre hybride évoque les rituels ancestraux de communication avec le vivant, de la culture de la chasse, Toribue japonais aux chants chamaniques. Ici, c’est la machine qui orchestre, sans remplacer la nature, mais en lui proposant un masque. Entre hyperréalité et fiction sonore, cette œuvre interroge la possibilité d’un langage commun ou sa perte définitive.
Dans How to Imagine the Unimaginable (2024), réalisée en collaboration avec Chen Zirui, , s’appuie sur une narration intime issue de la restauration des dessins d’enfance représentant des dinosaures, vestiges d’un imaginaire forgé avant même l’accès au langage. En les hybridant avec des images générées par intelligence artificielle, inspirées des premières reconstitutions paléontologiques et des représentations médiatiques, ils reconfigurent la mémoire visuelle d’un passé fantasmé. L’œuvre oscille entre restitution et invention, entre réparation et dérive. En confrontant l’innocence du geste enfantin à la froideur générative des algorithmes, le duo interroge ce que l’on transmet et ce que l’on perd dans le passage d’un imaginaire analogique à un imaginaire machinique. La fiction devient un lieu de survie, un langage spéculatif pour habiter les failles du réel.
L’exposition se termine avec Lasermice Dyad (2020), une installation interactive de So Kanno. Dans l’obscurité, un essaim de souris robotiques parcourt l’espace, animé par des moteurs vibrants et des électroaimants qui modulent l’environnement selon une logique de chaos organisé. Initialement inspirée par la synchronisation silencieuse des lucioles, l’œuvre rend visible une communication invisible. Des faisceaux laser se croisent, les couleurs changent, les rythmes battent. Les échos des moteurs et les scintillements de lumière se rejoignent, immergeant le spectateur dans une tension fluide entre ordre et désordre. Nous sommes attirés par les systèmes de communication et les phénomènes du monde animal, tels que les chœurs de grenouilles, les chants de criquets ou les vols d’oiseaux. L’installation cherche à inventer un nouveau système de langage à travers un algorithme original. Sa chorégraphie minimaliste devient une métaphore du comportement collectif, évoquant les émeutes, la contagion, ou les vagues émotionnelles. Elle pointe vers la complexité fragile des systèmes, où le moindre changement peut entraîner un effondrement en cascade.
Ici, le mouvement devient une trace écrite, et le désordre se transforme en code.
Texte par Paula Zeng
*“The horizon quivers. Orientation has become disorientation.”
Hito Steyerl, In Free Fall: A Thought Experiment on Vertical Perspective, e-flux journal no. 24 (2011).
Liu Guangli & Wu Huimin
Liu Guangli
Liu Guangli est né en 1990 à Lengshuijiang, en Chine. Il vit et travaille actuellement à Paris. Il est diplômé du Fresnoy – Studio national des arts contemporains en 2020. Le travail de Guangli naît souvent de l’intersection de différentes approches de la représentation de l’histoire et des événements, pour trouver ensuite sa propre forme dans des installations, vidéos, documentaires et peintures. Ses œuvres suggèrent que notre compréhension du présent est souvent façonnée par des langages préexistants, des normes sociales et des formats médiatiques par lesquels les informations sont transmises.
Il a remporté le Golden Nica et une Mention Honorable dans la catégorie Animation par ordinateur à Ars Electronica (2021, 2022), la Clé d’or du Meilleur court-métrage au Kassel Dokfest (2021), une mention spéciale au Prix Découverte Jimei x Arles (2023), ainsi que le Prix de l’exploration artistique remarquable au Festival international du court-métrage de Pékin (2023).
Wu Huimin
Wu Huimin, née en 1989 ou 1991 dans Shanxi, vit et travaille actuellement à Paris. Diplômée de l’Académie des Beaux-Arts de Tianjin et de l’École Supérieure d’Arts Plastiques de Monaco (Pavillon Bosio), son année de naissance varie selon les contextes. Cette incertitude temporelle nourrit son intérêt pour la dérive des événements et les frontières floues entre identité et réalité. Ancrée dans une observation attentive des dynamiques sociales et des faits d’actualité, sa pratique s’amuse à naviguer et à se conformer aux réalités mouvantes, capturant les liens subtils entre les individus et leur environnement en perpétuel changement.
Thomas Garnier
Né en 1991, Thomas Garnier est un artiste contemporain et plasticien français. Il a d’abord suivi une formation d’architecte à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Val de Seine. Il est ensuite diplômé de l’Atelier national d’art contemporain du Fresnoy où il reçoit le prix ‘’Révélations des arts numériques’’ de l’ADAGP, société des artistes français, pour son installation de fin d’études Cénotaphe.
Depuis, son travail a été présenté lors d’expositions internationales, de foires, de festivals et de biennales tels que la Nuit Blanche (Bruxelles, Belgique), la biennale d’art médiatique WRO (Wroslaw, Pologne), la biennale Nemo et la biennale Chroniques (Paris et Marseille, France), le festival et le musée Ignite (Miami, États-Unis), la foire d’art médiatique Noise (Istanbul, Turquie) et dans des fondations telles que la Fondation Fosun (Shanghai, Chine) et la Fondation Fiminco (Paris, France).
Sa pratique est celle d’un artiste mais aussi d’un chercheur ou d’un hétérotopologue, tel que défini par Foucault dans son texte ‘’les espaces autres’’. Cette recherche et construction de sens dans le liminal et dans les états d’entre-deux l’amène à produire des paysages de maquettes en béton automatisés et en effondrement, des images en boucle infinie de photocollages de ruines, des affichages qui composent aléatoirement des accumulations linguistiques et des projections d’ombres robotisées à partir de sculptures en fil de fer imprimées en 3D.
Il recherche ainsi des lieux singuliers et lointains qui interrogent la fabrication consciente et inconsciente de l’espace. Le caractère critique des œuvres se développe à travers la déambulation, l’observation d’espaces réels. Dans le travail de Thomas Garnier, on semble assister à l’archéologie d’un monde dérivé et à la dérive, pris entre et obsédé par la congrégation de temporalités et de techniques multiples, issues d’un primo-futu-risme inexistant, d’un rétro-additivisme, d’un multi-brutalisme, d’un supra-romantisme ou de toute accumulation de mots dont vous pourriez rêver par vous-même.
So Kanno
Né en 1984 au Japon et basé à Berlin depuis 2013, So Kanno est un artiste qui travaille sur les médias. Il est diplômé de l’Université d’art de Musashino, puis de l’Institut des arts médiatiques et des sciences avancés (IAMAS). Il est actuellement professeur de projet à l’Université des arts d’Aichi au Japon.
La pratique artistique de Kanno tourne principalement autour de la robotique. Parmi ses œuvres, citons « Lasermice », un essaim de robots conçus pour imiter le comportement collectif de petits animaux, et « Kazokutchi », un hôte robotique pour la vie artificielle numérique représentée sous la forme de NFT. Plutôt que de rechercher un contrôle parfait et typique de la robotique industrielle, Kanno explore l’imprévisibilité, l’émergence et les erreurs du système. Il conçoit intentionnellement des systèmes qui englobent et amplifient ces qualités. Sa pratique s’exprime en installations, performances et workshop. Il utilisent fréquemment ses propres robots, qui sont souvent le résultat des collaborations.
Curatrice
Paula Zeng
Paula Zeng est curatrice, chercheuse et chargée de projets artistiques. Elle est diplômée du département d’histoire de l’art et d’archéologie de Sorbonne Université, ainsi que de l’Académie des beaux-arts de Tianjin.
Ses recherches académiques antérieures se sont concentrées sur la performativité du médium de l’image dans la documentation de l’art d’installation et de la performance, ainsi que sur les structures de pouvoir et les violences latentes à l’œuvre dans les systèmes contemporains de production et de diffusion de l’image. Ces dernières années, sa pratique curatoriale accompagne le développement de la recherche artistique interdisciplinaire et multimédia, tout en favorisant la coopération et les échanges internationaux.
Elle a travaillé au Centre Wallonie-Bruxelles à Paris, dans des galeries internationales, des studios d’édition indépendants et des organisations artistiques à but non lucratif. Elle a coordonné ou contribué à plus de trente projets d’expositions internationales, parmi lesquels : Playlab, Inc. à la K11 Foundation (2020), la Biennale NOVA_XX au Centre Wallonie-Bruxelles (2021), ou encore le Festival Traversée du Marais (2022). Elle a également été commissaire exécutive de la première exposition d’Oplineprize en Chine (2019). Depuis 2017, elle collabore régulièrement aux expositions et projets du Studio Paramonumental.