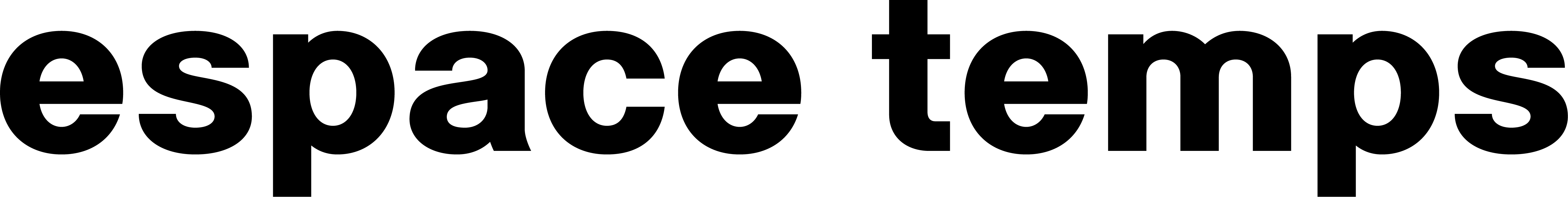Planaomai
19 Février 2026 – 09 Avril 2026
Vernissage le 19 Février 2026 à partir de 18h
Artistes
Aung Ko
Charlotte Moore
Marisa Müsing
Xu Fang
Curatrice
Adelaide Gnecchi Ruscone
Planaomai
Si l’on reprend l’étymologie du mot planète qui vient du grec planaomai pour “errer, se perdre”, on pourrait penser à un mouvement, une errance. Le monde serait donc la condition d’un changement perpétuel, autrement dit une métamorphose – non pas simplement le théâtre d’une portion localisable de sa sphère, mais la matière et la forme en constante évolution qui rythment son mouvement. Ainsi, l’exposition dans la galerie espace temps s’ouvre comme un jardin secret dans lequel chaque fleur dessine son souffle et se transforme au contact avec le monde. Les œuvres de Xu Fang, Aung Ko, Marisa Müsing et Charlotte Moore résonnent autour de la figure de la fleur ou microcosme qui devient non seulement symbole, mais aussi assemblage de différentes espèces par interconnexion et symbiose. L’exposition explore les multiples manières dont ce motif se transforme, circule et agit comme mémoire et espace de métamorphose. La fleur devient ici espace d’échange et de symbiose, au sens proposé par la biologiste américaine Lynn Margulis : un milieu dans lequel les différentes espèces s’influencent et se soutiennent. C’est une surface d’attraction, un point de rencontre avec l’inconnu, un seuil. Où le pollen d’une fleur s’envole-t-il ? Quelle influence exerce-t-il sur ce qu’il rencontre ? Comment peut-il transformer ?
Habiter la peau: négociation interspécifique et tension vitale
Dans l’œuvre de Xu Fang, nous faisons l’expérience d’un microcosme, un cocon, un embryon à l’intérieur duquel se forme une image-monde. La peau qui nous sépare du monde n’est rien d’autre que le seuil à travers lequel nous entrons en relation. En effet, il n’y a pas de séparation, chaque être participe à un réseau interconnecté par le même souffle. Le souffle du monde qui nous pénètre et dans lequel nous pénétrons. La survie implique l’occupation ou la négociation d’un espace. Les êtres humains, en tant qu’hétérotrophes, survivent en absorbant d’autres vies. Le philosophe italien Emanuele Coccia nous parle d’une théorie du mélange dans laquelle le cycle de vie est en constante évolution à travers les corps.
Xu Fang se laisse influencer par les matériaux qu’elle collectionne, les assimile par associations et les laisse agir au fil du temps : une moisissure se forme, une couleur change avec l’exposition aux rayons UV, une couche de peau se décompose. Dans Brûler ma peau, la peau n’est pas qu’une simple enveloppe ou une armure protectrice, mais plutôt un organe vivant, sensible et poreux, capable de percevoir, de réparer et de se laisser transpercer.
Sous la première couche de la sculpture se cache l’écorce d’eucalyptus : un arbre qui, pour grandir doit se dépouiller cycliquement de sa couche superficielle, « une violence lente mais nécessaire », selon les mots de Xu Fang. Comment la vie est-elle perpétuée à travers le contact, les cycles vitaux et la transformation ? Comment la destruction peut-elle devenir un élément de conservation ? Ces questions deviennent récurrentes dans son œuvre, la confrontation ne se veut ni spectaculaire ni uniquement violente. Elle se manifeste à travers des gestes ordinaires, comme dans L’enfant est déjà parti, où une poussette devient cuticule abandonnée. L’individu se forme et se transforme continuellement à travers l’abandon d’une partie de soi ou d’un objet.
Au cours de notre existence, nous changeons de peau, nous nous séparons des couches du temps. Réservoir et point liminal, surface de contact et zone de passage, l’épiderme archive et se transforme. Chaque corps subit des altérations : il se décompose, devient nourriture pour d’autres formes de vie, devient muqueuse, moisit, devient matière organique. La protection est toujours quelque part destruction. Dans Io, sous la peau noire, le pigment noir de la moisissure réduit les dommages causés par le contact du crâne avec la lumière du soleil en créant une stratification supplémentaire.
La peau devient un seuil ambigu : elle protège et sépare du monde extérieur tout en restant l’habitacle de différentes formes de vie comme les microbes ou micro-organismes. Habiter signifie ici absorber, consommer, occuper un espace. Nous vivons toujours dans un espace conçu et construit par d’autres agentivités. Vivre, dans un certain sens, signifie s’approprier de cet espace et négocier une zone commune possible, comme dans la sculpture de Fang Xu, où la peau devient un environnement de métamorphose active, de négociation entre différents organismes qui opèrent sur cette couche. Il en résulte une tension qui est vitale. Pour reprendre les mots du poète franco-chinois François Cheng, la vie est quelque chose qui advient et qui devient. Dans la théorie du mélange de Coccia, un corps au cours de son cycle de vie est susceptible à la mutation, au changement de forme, en modifiant à son tour l’autre.
Le jardin comme refuge: métamorphose et résistance du vivant
Dans After Black de Aung Ko, on trouve des particules de fleurs, des souvenirs sédimentés, des fragments de vie, des éclats enfoncés dans la peau qui se fondent sur la toile déchirée par l’acrylique noir comme si elle était carbonisée. Le noir dans ses œuvres devient presque impénétrable : les surfaces picturales, visqueuses et profondes, restituent l’écho d’un passé traumatisant, celui d’une ville – la sienne – dilacérée jusqu’à devenir méconnaissable. Contraint de quitter sa ville après le coup d’État militaire en 2021 au Myanmar, Aung Ko conserve dans sa pratique des blessures profondes, intimes et collectives. Il vit à Paris depuis quelques années, en exil de son lieu d’origine. Dans ses souvenirs réapparaissent les rues recouvertes de charbon, les incendies qui dévorent les maisons, les forêts disparues. Dans ses peintures, ces images ne se renferment jamais, elles restent comme des blessures ouvertes mais servent aussi comme matière de réélaboration. L’artiste s’inspire en effet de la philosophie bouddhiste, qui voit dans la renaissance et le cycle de vie une autre façon d’affronter la mort. Les fleurs sont toujours présentes dans ces lieux de prière, accompagnant le rituel.
En dialogue avec les peintures, une vidéo qu’Aung Ko a réalisée en 2020, lors de son retour au village de ses parents avec sa fille Dahlia. Ces fragments nous ramènent aux techniques de construction des radeaux de bambou, une activité qui traverse ses souvenirs d’enfance et que désormais il voit sous un regard différent, accompagné par celui de sa fille et des habitants du village. Il nous dévoile une archive personnelle et intime, née de la rupture et de la nécessité de trouver un espace de résilience.
À leur arrivée en France, Aung Ko et sa femme Nge Lay se sont lancé.e.s dans une pratique thérapeutique à travers le jardinage, transformant la cour de la Cité Internationale des Arts en un Éden. Le jardin devient espace de refuge, de paix et de reconstruction. Le mot jardin vient de l’allemand Garten qui signifie « enclos » (hortus conclusus en latin). Selon le biologiste et paysagiste français Gilles Clément, cultiver un jardin est une forme de protection d’un bien précieux. En même temps, comme le rappelle Emanuele Coccia, c’est la plus ancienne forme de production du vivant, le milieu où les plantes ont rendu possible la vie sur Terre en produisant de l’oxygène. Les plantes sont, en ce sens, les premières jardinières du monde. Dans l’œuvre de Aung Ko et Nge Lay, le jardin-refuge devient un lieu de soin conçu en hommage aux vies déplacées, aux artistes contraint.e.s au silence qui vivent en exil comme condition permanente.
La série After Black, composée de huit peintures réalisées à partir de techniques mixtes et développées dans les ateliers du Palais de Tokyo, de la Cité des Arts et des Beaux-Arts, poursuit ces réflexions. Une matière dense, créée à travers un lent processus de stratification de couleurs, successivement recouvertes d’une couche d’acrylique noir. Les formes rappellent celles des troncs d’arbres, les cendres de fleurs se mélangent à l’acrylique. Les surfaces noires, semblables à des entrailles écorchées ou des squelettes brûlés, renvoient au pays natal de l’artiste, où la surproduction de charbon rythmait le quotidien. L’exploitation du charbon a entraîné la disparition d’immenses forêts, et lors du coup d’État, de nombreuses maisons situées à proximité ont été incendiées, détruisant des hectares entiers de ces poumons verts.
C’est à travers les plantes que s’opère la métamorphose continue de la planète : nous respirons le monde, et le monde nous respire à travers cette transformation incessante dont nous faisons partie. Dans cette perspective, il n’est plus possible de distinguer nature et culture. Le travail d’Aung Ko s’inscrit dans ce seuil poreux, où le traumatisme se mêle au vivant, et où la peinture devient acte de résistance, de guérison et de métamorphose. La vie peut être pensée comme la réélaboration collective d’un traumatisme originel, celui de la naissance du monde. Quand tout brûle, c’est déjà le début d’une renaissance, les fleurs naissent des cendres et le cycle vital reprend son cours. Dès lors, on peut traverser la galerie espace temps comme une sorte de jardin qui nous révèle une image-monde. Lorsque tout sur la planète était à l’état liquide et stérile, les plantes ont commencé à créer un espace habitable sur la surface de la Terre en produisant l’oxygène qui façonne notre respiration ; plus qu’une entité zoologique, le monde est une entité végétale.
Ecologies relationnelles et morphologies hybrides
Dans l’œuvre de Charlotte Moore et Marisa Müsing, les matériaux se fondent les uns dans les autres, créant une friction entre deux opposés : la céramique, fragile et poreuse, et le métal, résistant mais oxydable. De cette rencontre naît une nouvelle espèce, un inter-être. Ces morphologies évoquent des formes vivantes, hybrides, en constante mutation, et nous transportent dans l’imaginaire de Mercè Rodoreda, à qui elles rendent hommage. Dans ses romans apparaissent des fleurs résilientes, chargées d’une force symbolique, traversée par la fragilité, la mémoire et la survie. Rodoreda, écrivaine catalane née en 1908, a été contrainte de vivre en exil en France et en Suisse à cause de la guerre et de la répression politique. Ses textes mêlent magie, symbolisme et rêve. La nature, et en particulier le monde végétal, devient dans ses écrits un espace de résistance et de transformation.
Les fleurs de Müsing et Moore s’inscrivent dans cette même tension imaginaire et peuvent être lues comme espace de fabulation spéculative, au sens défini par la philosophe américaine Donna Haraway. Elle utilise ce terme pour désigner la capacité d’imaginer des mondes possibles même au milieu d’un désastre, lorsque le récit n’est plus seulement une dénonciation, mais devient un outil pour créer de nouvelles alliances et formes de survie. Dans l’œuvre, le dialogue s’établit à travers le cadavre exquis, une technique surréaliste qui devient une méthode d’élaboration pour Müsing et Moore. Il en résulte une narration dans laquelle les altérités se transforment jusqu’à se ressembler. La céramique, matière première provenant de la terre où naissent les fleurs, se fond avec le métal. De cette tension matérielle naissent des formes hybrides, se sculptent des rencontres inattendues entre différentes espèces, qui collaborent pour créer une image du monde, ou plutôt une image-monde, vibrante et relationnelle.
Dans le paysage numérique actuel, saturé par les médias où prévalent l’accumulation et le glissement, les formes se confondent et se contaminent dans une étrangeté diffuse. Sur Internet, les objets se transforment par collision : la tête d’un chien peut se fondre dans la racine d’un mimosa. Au contraire, dans le monde non-numérique, la nature ne fonctionne pas par morphing, mais par des connexions précises et localisées, comme celles que créent les fourmis tisserandes en suspendant leurs nids aux arbres. Les histoires qui émergent de ces relations sont des constructions collectives, faites de liens délicats entre les objets, les espèces et les environnements. Ces formes répondent au désespoir contemporain et proposent un contre-récit à ce que les biologistes appellent aujourd’hui le Miocène, l’ère de la viscosité, où l’effondrement des écosystèmes produit un monde confus, amorphe et indifférencié.
Ainsi, le triptyque Dead Flower, Water Flower et Mean Flower prend forme à partir des fleurs qui traversent les récits de Rodoreda. À travers un dialogue entre vidéo, sculpture et pièces murales, Müsing et Moore composent un jardin enchanté qui nous transporte dans une dimension onirique. Les références biologiques et artistiques – des herbiers italiens du XVe siècle (Erbario) à l’Urpflanze de Goethe, jusqu’aux illustrations de Maria Sibylla Merian – nourrissent une iconographie où science, imagination et mémoire végétale s’entrelacent.
Comme dans un cadavre exquis, les formes se contaminent et s’influencent mutuellement. La vie devient chimérique, traversant les corps et les espèces dans un cycle sans fin. Cette dynamique se cristallise dans l’image de la fleur, à travers laquelle la plante confie son avenir à une autre espèce. L’insecte devient alors généticien, éleveur, agriculteur. La fleur ne se contente pas de coopérer avec l’abeille, mais transfère une partie de son intelligence végétale dans le corps d’un autre règne. Ce geste ne constitue pas une simple collaboration, mais l’émergence d’un organe cognitif et spéculatif interspécifique, dans lequel la pensée, la reproduction et l’imaginaire se déploient au-delà de toute frontière fixe. Dans cette perspective, l’alliance avec les fleurs proposée par la lecture de Müsing et Moore se présente comme une pensée tentaculaire, dans laquelle chaque élément est connecté aux autres au sein d’une image-monde.
PLANAOMAI se referme ainsi comme un jardin en mouvement, où les œuvres ne proposent pas une image figée du monde, mais un espace relationnel en devenir. La fleur devient alors un espace vital, un lieu où se négocient la perte, la survivance et la possibilité d’autres formes de vie partagée. Rien n’existe de manière isolée : les formes, les matériaux, les imaginaires et les récits s’entremêlent, générant un écosystème sensible dans lequel l’humain et le non-humain cohabitent, créant des métamorphoses à l’état collectif.
Adelaide Gnecchi Ruscone
Artistes
Aung Ko
Aung Ko est né au Myanmar et s’est exilé de son pays fin 2021. Artiste contemporain originaire du Myanmar, il travaille la peinture, le film, l’installation et la performance. Son œuvre constitue un commentaire continu sur les contextes politiques et sociaux du Myanmar contemporain, abordant notamment les thèmes de la censure, de l’injustice et du pouvoir.
Il a participé à Documenta 15 (Kassel, Allemagne, 2022), à la Biennale de Singapour (2008) et à la 4e Triennale d’art asiatique de Fukuoka. Il a également été artiste en résidence au Pavillon du Palais de Tokyo (2014–2015). En 2024, il a présenté une exposition et résidence au Palais de Tokyo, suivie d’une exposition au Musée national de l’histoire de l’immigration (Palais de la Porte Dorée) en 2024–2025.
En 2007, il a initié le projet au long cours Thuyédan Village Art Project dans son village natal. La principale source de revenus du village est la production de charbon. Isolé, et situé à proximité d’une usine de munitions, le village vit dans la peur tandis que les visites et la médiatisation y sont généralement interdites. Avec son épouse, l’artiste Nge Lay, Aung Ko y invite des artistes à créer des performances, des sculptures mobiles et d’autres formes de collaborations artistiques avec les villageois et leurs habitant·e·s.
Charlotte Moore
Née et élevée dans la vallée de la Tamar, en Cornouailles, sa pratique est façonnée par le paysage post-industriel marqué par l’exploitation minière et l’agriculture. Elle examine comment l’activité humaine façonne les transformations botaniques, en s’intéressant à la manière dont les communautés végétales réinvestissent les architectures et les terrains abandonnés, et propose de nouvelles formes de coexistence entre l’humain et la nature.
Formée en architecture et travaillant principalement la céramique, elle associe procédés analogiques et numériques au sein de projets de recherche in situ. Son travail engage les communautés locales et interroge les enjeux éthiques des archives, des herbiers et des banques de semences dans le contexte de l’adaptation climatique et de la préservation de la biodiversité. Elle développe actuellement une recherche en céramique architecturale autour d’une banque de semences communautaire dédiée à la régénération des plantes natives après les incendies.
Parmi ses projets récents figure Cornubia Tropicus (WhiteGold Project), qui explore les mutations écologiques des anciennes carrières de kaolin à St Austell. Ce projet a reçu le prix CBG pour « Use of Clay » et « Cornish Distinctiveness ». Elle est lauréate du prix BLAZE TO BLOOM, British Ceramics Biennale 2025–2026.
Elle est diplômée d’un Master en Architecture (avec distinction) du Royal College of Art (2019) et d’un Bachelor of Science (avec mention First Class Honours) de la Welsh School of Architecture, Cardiff University (2015).
Marisa Müsing
Marisa Müsing est une artiste transdisciplinaire et penseuse cybernétique qui explore les relations entre le corps, l’identité numérique et l’histoire archéologique, exprimant des idéaux féministes éthérés à travers des médias numériques et sculpturaux. Leur doctorat au Royal College of Art réexamine les fresques pompéiennes à travers un prisme cyberféministe queer.
Iel a exposé son travail à la Royal Academy of Arts, à la British Academy, au Salone del Mobile, à la New York Design Week, ainsi que chez SOFTER, Ethereal Maison, Restless Egg et Xpace Cultural Centre. Son travail a été présenté dans Glitch Magazine, Digital Frontier, Hypebae, WGSN, Dezeen, Vogue et le New York Times.
Marisa a donné des conférences dans des institutions telles que le RCA Research Biennale Symposium, Parsons School of Design, Harvard GSD, Rhode Island School of Design et ELISAVA Barcelona School of Design and Engineering.
Par ailleurs, Marisa dirige deux studios collaboratifs : müsing-sellés, un studio de design et d’enseignement reconnu à l’échelle internationale, engagé dans la transformation du design d’objet et d’espace à travers l’architecture ; et mamumifi, un collectif multidisciplinaire qui explore la construction de récits autour de l’identité à travers des objets, depuis des perspectives féminines mixtes-asiatiques.
Xu Fang
La pratique de Fang Xu s’articule autour d’une compréhension non oppositionnelle des structures. Dans ses œuvres, les oppositions ne constituent pas des conflits à résoudre, mais des résultats parallèles d’un même processus vital opérant à différentes échelles. Tout acte perçu comme raisonnable, nécessaire ou bienveillant implique inévitablement, au moment même où sa légitimité est établie, des formes d’appropriation, d’exclusion et de sacrifice.
Dans les installations de Fang Xu, l’action se poursuit sans jamais mener à une sortie. Des fourmis cherchent indéfiniment une issue à l’intérieur de boîtes lumineuses ; le système ne se maintient ni par l’effondrement ni par une stabilité imposée, mais par la limitation. De la vie à la mort, l’action est continuellement poussée en avant, et son sens ne réside pas dans l’aboutissement, mais dans la continuité contrainte du processus lui-même.
Les plantes continuent de croître tout en étant coupées. Le système se maintient par la restriction plutôt que par la destruction. Dans cette pratique, couper et protéger ne sont pas des gestes opposés. La survie implique en elle-même une absorption, une transformation et une consommation constantes, tandis que les distinctions entre le « bien » et le « mal » relèvent davantage de jugements anthropocentriques que de la logique interne du fonctionnement du vivant.
Les œuvres de Fang Xu ont été présentées notamment au Grand Palais Éphémère à Paris et à la Galerie Hausgeburt en Allemagne. Sa pratique à long terme s’articule autour des systèmes, des cycles et des structures du vivant.
Curatrice
Adelaide Gnecchi Ruscone
Adelaide Gnecchi Ruscone (Milan, 1997, elle/iel) est une curatrice indépendante, basée entre Venise et Paris. Ses recherches portent sur l’écologie queer et l’hydroféminisme, avec une thèse sur la lagune de Venise en tant qu’espace relationnel. Cofondatrice du collectif Torbida et Venti Erranti, elle collabore régulièrement à diverses initiatives, notamment le projet curatorial La Festa del Rumore (Venise), qui propose des conférences, des ateliers et des performances, et le festival d’art vidéo pour les insulaires et les pêcheurs Bogiaiasso (Chioggia). L’une de ses publications les plus récentes est L’indicibile Volume, une exploration collective à travers des états altérés de conscience, publiée par Kunstverein (Milan).
espace temps
espace temps est un organisme qui se situe au coeur de Paris, à proximité du Centre Pompidou. Il est dédié à l’organisation d’expositions et d’événements de recherche, tout en favorisant les rencontres et les échanges.
98 rue Quincampoix 75003 Paris
Du mercredi au vendredi 14h – 19h
Le samedi 11h – 19h
espacetempsart@gmail.com